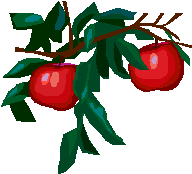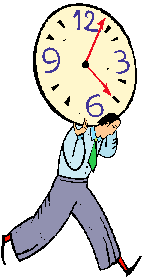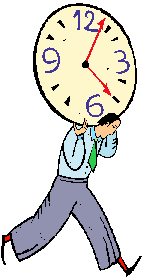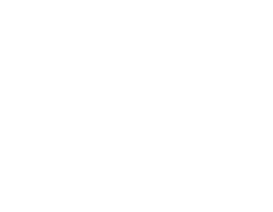SOMMAIRE DE LA CAUDRIOLE N° 15
Juillet-Août-Septembre 2005
Illustration BD
page 2
|
Patrick MERIC
|
Mon coup de cœur ! page 3
|
Denise LEPRÊTRE
|
JEUNES
|
|
La
force page 4
|
Préscillia
TRIGO |
Pomme
rouge page 4
|
Collège
RENAUD-BARRAULT |
|
Poème page 5 |
FLORENCE |
|
Temps passé page 6 |
Christelle LESOURD
|
|
Le p'tit
oiseau page 6 |
LUCIOLLE |
|
Premiers instants… page 7 |
Ecole
St Michel |
|
Anonyme page 7 |
Caroline
LALISSE |
|
ADULTES |
|
|
T'es où ? page 8 |
Marie-Antoinette
LABBE |
|
Je suis un cœur solitaire page 8 |
Thérèse
LEROY |
|
Grandir page 8 |
Suzy
DARRIBEHAUDE |
|
Le bengali page 9 |
Yann
VILLIERS |
|
Elle court page 9 |
Floriane
KUROWIAK |
|
Bain de jouvence page 10 |
Thérèse
FABIAN |
|
Pour Mathieu page 11 |
Marie-Jo
WANESSE |
|
La légende de Saint Nicolas page 11 |
André
NOIRET |
|
L'amour page 12 |
Guislaine
LAURENT |
|
L'art de vieillir page 13 |
A.BLOT |
|
Açvine
6/24 page 13 |
SAINT-HESBAYE |
|
Trébucher sur … page 14 |
Brigitte
CAPLIEZ |
|
NOUVELLES |
|
|
La cueillette page
15-16-17 |
HERTIA-MAY |
|
Le strapontin page
18-19-20 |
Paule
LEFEBVRE |
|
Le service est compris
page 21-22-23 |
GRASJACQS |
|
Histoire de classe
page 24-25-26 |
Jean-François
SAUTIERE |
|
Les écheveaux du destin
page 27 |
Alfred
LENGLET |
|
Vacances de rêve
page 28-29-30 |
Geneviève
DEMARCQ |
|
Un petit rien page 31 Sortie
Min Grind-père y disot toudis page32 |
Julie VASSEUR Hector MELON D’AUBIER |
|
|
|
|
* Retrouvez l’auteur dans la revue littéraire. |
|
NOUS
SOUHAITONS À TOUS NOS LECTEURS
D’AGRÈABLES VACANCES
|
MON COUP DE COEUR ! |
|
|
|
La
production romanesque française de ces années-ci n'est pas sans intérêt…mais
où sont "les très grands" d'il y a 40 ou 60 ans ? Ne
soyons pourtant pas pessimistes ni chauvins ; du monde entier, comme l'écrit
Michel de Bris, nous vient : "une littérature voyageuse, aventureuse,
ouverte sur le monde, soucieuse de le dire…" et je vous avoue tâter,
souvent des romans étrangers… L'un
de mes derniers bonheur : "seule, la mer" de l'écrivain israëlien
Amos Oz accueilli par une presse enthousiaste. Cela se passe à Tel-Aviv : un
veuf…une vieille amie, veuve elle aussi, tout leur entourage, parfois un peu
inquiétant…le fils du veuf Rico, parti à la recherche de lui-même en plein
Himalaya…car cela se passe aussi au Tibet avec les inquiétudes et les
rencontres de Rico…mais servi par une façon d'écrire extraordinaire : on
passe de la prose poétique au poème, et à la prose tout court…Une page…ou
moins…ou un peu plus pour faire avancer l'histoire ou les questionnements des
personnages. C'est
beau…parfois déconcertant…Tous les héros du livre – et le narrateur lui-même
! – finissent par devenir de votre famille…Un roman –poème ou un poème qui se
lit comme un roman ? c'est l'un de ces livres rares que l'on a constamment
envie de relire parce qu'on les sent inépuisables comme la vie. D.LEPRÊTRE "Seule la
mer" d'Amos OZ chez
Gallimard |
|
LA FORCE |
|
|
|
Je voudrais me donner la force d’exister Quand tu n’es pas là !
Un jour je partirai Un jour je m’enfuirai Pour te laisser seul sur cette
terre Et pour que tu puisses faire ta prière. Préscillia Trigo |
|
|
|
|
|
Pomme rouge Celle qui vient De mon arbre Pourquoi ne tombes-tu pas ? Pomme rouge Celle qui a la couleur De mon sang Pourquoi ne coules-tu pas ? Pomme rouge Celle qui est acide Pourquoi le vent ne t’emporte pas ? C’est mon secret. Laura Collège Renaud-Barrault
d'Avesnelles |
|
POEME |
||
|
|
|


|
TEMPS PASSÉ |
|||
|
|
|
|
|
PREMIERS INSTANTS… |
|
|
Oui, je suis né
avec toi : Longtemps tu m’as
protégé, Jour après jour,
tu m’as bercé, De ta tiédeur
enveloppé. Dès mon tout
premier cri, Je te retrouve
pour le bain. Mon hurlement
retentit, J’ai même déjà un
peu faim. Dès ma première
tétée, Dans le lait, je
t’ai trouvée. Partout, tu t’es
cachée, A moi de te
retrouver ! Quelle est cette
sensation de chaleur, Oh ! Confort
douillet, dont je n’ai pas peur ? Et oui ! J’ai
fait… « pipi », Et là, tu es
partie ! Que veux-tu que je
te dise ? Ce n’est que
partie remise… Car à chaque
instant de ma vie, Je te retrouverai,
mon amie : Car, ensemble nous
ferons le chemin, Et tu me guideras
vers demain ! Guislaine LAURENT Ecole Saint Michel Classe Maternelle – Grande
section |
|
|
|
|
ANONYME |
|
|
|
Je
suis la cible Des
flèches brûlantes D’amours
impossibles De
douleurs hurlantes Je
pleure la nuit Et
je fuis la vie. Caroline Lalisse |
|
T'es où ? |
|
|
|
T’es où ? T’es où ? T’es où ? La main en haut Si c’était beau Ce serait du Bécaud T’es où ? T’es où ?
Wagner appelle Verdi Les Beatles de nouveau réunis Laideur et cacophonie T’es où ? T’es où ? T’es où ? En coquille, sur l’oreille Haut la main Et la lèvre groseille T’es où ? T’es où ? T’es où ? Mensonge et noirceur Pour ces hâbleurs Les braqués du portable… de Marie-Antoinette LABBE |
|
CŒUR SOLITAIRE |
|
|
|
Je suis un cœur solitaire perdu dans les
ténèbres. Je suis une âme perdue peut-être
à jamais. Une âme perdue dans la foule. Les étoiles s’éteignent une à
une, Les ténèbres recouvrent le monde Et la mort plane sous forme de
société pourrie. Thérèse
Leroy 18 mai
1970 |
|
|
GRANDIR Grandir, c’est d’abord…
S’inventer des pays plus bleus que
l’océan, Retourner les nuages et découvrir
le ciel, S’émerveiller de tout, voir briller
l’étincelle. Grandir, c’est encore… Embrasser l’univers d’un regard qui
apprend, Accrocher des étoiles au bleu nuit
de l’écran, Tenir le gouvernail d’un bateau déroutant, Incliner d’un degré la direction du
temps. Grandir, c’est enfin… S’interroger sur tout, ne répondre
sur rien, Cueillir la fleur de vie et l’effeuiller
sans fin, Echeveler les anges riants et
poupins, Partir et revenir au pays d’où l’on
vient. Suzy DARRIBEHAUDE |
|
Le Bengali (1) |
||
|
|
|
|
ELLE COURT
|
|
|
|
Elle court elle court la jeune fille Elle court avec les yeux qui brillent Elle court elle court les
cheveux au vent Elle court droit devant Elle court elle court mais après quoi ? Elle court éviter ses soucis et tracas Elle court elle court mais
après quoi ? Elle court peut-être après
la vie et ses joies Elle court elle court le nez au vent Elle court droit devant Elle court elle court les
bras tendus Elle court vers son futur Elle court elle court les mains ouvertes Elle court fière d’être Floriane
Kurowiak Avril
2004 |
|
BAIN DE JOUVENCE |
||
|
|
|
|
POUR MATHIEU |
|
|
|
Ce soir, j’ai pensé à l’Exode, ce livre de la bible. Irraisonnée, J’ai cru voir en toi, mon bébé, cet enfant abandonné, Dans une arche de papyrus, enduit de bitume et de poix,
Pharaon tenait en esclavage les enfants d’Israël. Ils se multipliaient, tant et tant, que la tyrannie Vint s’abattre sur eux : les mâles seraient rebelles, Plus personne ne devait leur donner vie. Beau comme il était, elle devait le cacher, Des mois durant, dans la peur qu’il se mette à pleurer Quand il ne fallait pas. L’aversion n’avait pas de limite, Et Pharaon l’aurait tué, si sa fille n’avait décidé de l’élever. Trouvé au bord d’une eau limpide, dans son couffin improvisé, Pleine de compassion, elle fit de lui, Moïse, celui « tiré
des eaux ». Quand je t’ai vu, mon enfant, couché dans le panier, Dormant comme un bienheureux, le chien à tes côtés, J’ai voulu et essayé de trouver en toi, celui qui demain Serait le seul à qui DIEU indiquerait le chemin : La droiture, la paix, la sécurité. Marie-Jo Wanesse |
|
LA LEGENDE DE SAINT
NICOLAS |
|
|
|
Si décembre enneigé au
vent fort de l’hiver Regorge d’histoires aux
mille chorégraphies La tradition nous parle de
ces 3 petits clercs Voulant rejoindre Athènes,
y faire philosophie ; Asile d’un boucher les
égorgeant sans fards Il les met au saloir aux
cochons mélangés Nicolas le grand Saint,
passant 7 ans plus tard Les ressuscite sur le
champ, la légende est forgée ; En Lycie (en Asie), un
soir au monde il vint Famille très riche issue,
influente et Chrétienne Redistribue fortune
lorsque parents défunts Apaise forte tempête quand
la mer se déchaîne ; Nicolas devint prêtre se
promène en terre Sainte Celui-ci prisonnier, la
paix de Constantin Le libère, il construit
des églises sans craintes Il devint archevêque et
fit miracles pleins ; Durant une famine il
aurait notamment Dans la ville de Myre
avant qu’il décéda Nourri population
miraculeusement ; Ainsi naquit légende de ce
saint Nicolas. Aujourd’hui il fait tour
des écoles maternelles Partageant friandises, aux
enfants si joyeux Qui piaillent
d’impatience, en attendant Noël Et Seigneur Jésus-Christ,
notre roi dans les cieux. André NOIRET |
|
L’AMOUR |
|
|
|
Dans la nature, un arbre resplendit. Libre, fier, son feuillage épanoui. A ses pieds, une minuscule liane rampe, … timidement. Petit à petit, elle arrive aux pieds de l’arbre, Jour après jour, pluie après pluie, Soleil après soleil, elle grandit Et grimpe, grimpe… Plus belle, plus forte, elle va, confiante, Remonte jusqu’au cœur de celui qui l’ignore Et ne se soucie guère de son sort. Un jour, un beau jour enfin, Elle arrive à hauteur de ce beau sir Qui pour elle, soudain brûle de désir… Côte à côte, ils ont grandi, puis vieilli. Et un jour ou plutôt une nuit, le vieil arbre s’est
endormi. A ses côtés, sa fidèle liane, complice de chaque jour,
se fane… Se laissant mourir, chaque jour un peu plus. Les racines enlacées peu à peu blanchissent : La vie s’en est allée ! Mais à tout jamais subsiste Pour que jamais ne finisse L’amour d’une liane pour un arbre, D’un arbre pour une liane. L’arbre c’est toi, c’est moi. La liane c’est moi, c’est toi. Dans la vie, rien n’est jamais gagné. L’amour le plus sincère, celui qui résiste à toutes les
intempéries, C’est l’amour du cœur, Celui qui donne, offre Qui reçoit parfois, pour être plus fort et se donner
encore…
|
|
L’ART
DE VIEILLIR EN
12 LECONS |
||||
|
|
André Blot |
|
TREBUCHER |
|
|
|
Trébucher sur le bord de son cœur, Et puis s’arrêter là, Bercé par sa douceur. Se réjouir alors D’un fruit qui est trop mûr Comme si son goût sucré Pouvait fermer les plaies ! Trébucher sur le bord de sa vie, Et puis s’accrocher là, Bercé par son ennui. Se réjouir alors D’un soleil qui éclate Et croire que ses rayons Feront ta guérison. Trébucher sur le bord de son rêve, Et puis s’envoler là, Bercé par une trêve. Se réjouir alors D’un vide qui étourdit Comme si une falaise Mettait fin au malaise ! Se relever d’un bond ! Et puis soigner ses bosses A grands coups de bonbons, Du temps où t’étais gosse ! Brigitte
Capliez |
|
LA CUEILLETTE DES CHAMPIGNONS |
|
|
|
Rien à dire !
Impeccable ! Le trajet concocté par Maurice M., adjoint, ne laissa pas
indifférent. Les plus jeunes firent ainsi connaissance avec le patrimoine
local : le bois du mont aux villes, le pont d’Inchy, les remblais, le
bois de Gatignie, la sotière, etc… Plus de cent cinquante participants
(154, me souffle l’adjoint aux sports). Une bonne réception aussi au resto
scolaire avec jus de fruits variés, casse-croûtes, café et chocolat… Le
fameux discours du maire Jean O. Le petit plus de cette
journée : la collecte de champignons trouvés sur les sentiers :
chanterelles, lépiotes, faux mousserons, coprins chevelus, agarics, etc… Un gobelet de café à la main, nous
nous rapprochâmes des végétaux parasites rangés sur une table et nous
évoquâmes les « parties » de cueillette. Je me revis dans les
pâtures avec Dédé de l’Aveyron, traquant les lépiotes pudiques sur la route de
Reumont, figé devant les hygrophores perroquets aux teintes magnifiques et
multiples. Je crus longtemps avoir rêvé en repensant à ces basidiomycètes
bleus, oranges, verts ou jaunes ! Dani le coiffeur vint nous
rejoindre, montrant les girolles placées près des pagnottes préparées par
Bernard le boucher. Guy L. nous remémora un célèbre
rallye de l’amicale laïque. « Avez-vous en mémoire la fameuse épreuve où
il fallait que chaque équipage ramène un satyre puant ou phallus
impudicus ? » Nous sourîmes : c’était le prof de sciences
naturelles qui parlait. « Vous allez
rire ! » Le groupe se retourna sur Bertrand L., dit le
« canari » à cause de sa passion pour les oiseaux. « Vous
allez rire ; gamin, j’allais aux quatre patûres sur le chemin de Maretz.
Il faisait à peine clair quand je vis derrière les « baillages » de
multiples taches blanches. Je retirai mon gilet et sautai les fils de fer
barbelés. Me penchant pour prélever délicatement mon repas, je me trouvai en
face de cailloux de craie destinés à l’amendage ». Je ne pus m’empêcher de lui
rétorquer : « c’est de famille, c’était pas ton frère qui avait vu
un ovni dans ce coin ? » Un autre personnage tourniquait
depuis dix minutes dans son coin avant de se décider à se rapprocher de notre
petit comité qui gagnait en nombre à chaque récit : Hubert, le visage encombré d’une
barbe digne du capitaine Haddock et d’une casquette de vieux loup de mer,
armé d’une pipe pour dernier décor. Ne s’encombrant pas de grandes
phrases : « Et Dédé qui ramenait des dizaines de kilos de pieds
bleus, le dimanche au café ? » « Tu parles : Dédé qui
rageait quand Alfred B. était passé avant lui, laissant comme traces des
cadavres de ces magnifiques tricholomes ». Nous tentions alors de
convaincre les clients de les cuisiner à la poêle comme un steak.
« Pierrot m’en a encore reparlé l’autre jour à Inter. Je ne l’avais pas
vu depuis plus de dix ans et l’anecdote qui lui est revenue était cette
histoire de champignons ! » Alors que les derniers participants
traînaient encore pour finir la matinée devant un apéritif, du moins
l’espéraient-ils ; alors qu’Antoine et les autres ados finissaient de
ranger les chaises sous les ordres de Maurice et de Claude ; alors que
Jean-Luc commentait une soirée de chasse aux coprins à la lampe de poche sur
le campus ; Guy T. se lança dans un récit tragi-comique. Je redoutais ce moment mais c’était
couru d’avance. Guy T. était un vieux copain
d’adolescence. Nous nous étions connus à l’école de musique et entre deux
séances de solfège ou répétitions de musique, il avait toujours une bonne
blague à diffuser ! A chaque fois que je le croisais, je l’associais à
cette visite du cimetière, pour voir les « feux follets » en
compagnie de Georges F. et d’Henri ! Bref : Guy T. était le
dénominateur commun de toutes les sorties et aventures douteuses : les
parties de pêche, le carnaval avec les manteaux de cow-boys, le jeu du
tirlipot aux anciennes écoles, les séances de ping-pong, la relance du
football en 1968, et les répétitions de théâtre dans la salle du presbytère… Avec son physique de « Grand
Duduche », il était redoutable quand il abordait ses récits. Le vin
était tiré, il fallait le boire ! Sa joute oratoire faisait d’autant
plus mouche qu’il prenait les autres à témoin et ce témoin, cette fois-ci,
était votre serviteur ! « Et la boum, la fameuse boum
où nous sommes revenus vers deux heures du mat avec Marcel D., Pierre M.,
Simon L., Charles M., tu rangeais les disques ! » Je dus répondre
en en convenant : « Il s’agissait de la fin de
la soirée aux anciennes écoles, l’argent était destiné à financer les futures
activités du club des jeunes. Il fallait terminer à deux heures comme c’était
d’accord avec le Maire. Nous restions à nettoyer la salle avec Bernard,
Claude, etc… Pour me débarrasser gentiment de ces
visiteurs, je leur lançai l’idée d’une cueillette de champignons. Je proposai
de retourner chacun chez soi pour se changer et nous nous mîmes d’accord pour
se retrouver chez Charles M. Descendant la rue avec mon sac de disques car je
faisais souvent le DJ ; habillé en tenue adéquate, je remontai la ruelle
à Baudet, puis la ruelle de Fervacques et les retrouvai devant la dite
maison. Les copains attendaient sur l’escalier. Nous entendîmes le père de
Charles vociférer, réveillé par les bruits que faisait son fils. « Quoc’chè
qu’t’fous ? » Réponse : « J’vais à
champignons ! » « A deux heures du
matin ? Mais t’es fou, min gaillard ! » Nous le vîmes enfin sortir, le
litron sous le bras ! J’informai alors mes compagnons des
meilleurs coins à agarics : les terrains devant l’ancienne brasserie,
sur la route de Clary, et nous voilà partis rue Delory. Passant devant une maison restée
allumée, Marcel sonna. La fille aînée nous ouvrit et fit du café. Nous
arrivâmes dans la pâture vers trois heures et ne trouvâmes que quelques
psalliotes. Il faut dire que nous n’étions que fin août ! Quelques bouteilles vides plus
tard, Simon nous persuada de pousser jusqu’à Clary où il avait un vieux
collègue de stage. Sur la route, nous croisâmes Monsieur le curé, revenant d’aller
dire la messe. Nous lui montrâmes le résultat de nos pérégrinations :
quelques végétaux frêles et maigrichons ! Arrivés devant la boucherie du
copain, Simon sonna. Son ancien collègue nous ouvrit, en même temps que sa
boutique et fit le café ». Guy reprit alors la parole, jugeant
que j’avais trop parlé : «C’est alors que le boucher, le
regard mauvais depuis le début de la rencontre avec notre troupe, se saisit
des bouteilles de pinard encore valides et les vida devant nos yeux médusés
dans le lavabo ». Le copain de Simon faisait partie
de la ligue anti-alcoolique, mais bien sûr, Simon l’ignorait. Hertia May Avertissement aux
lecteurs : les prénoms sont purement fictifs. |
|
LE
STRAPONTIN ou Les malheurs d’une octo… comme ils disent |
|
|
|
Il était une colonne qui méritait
amplement son statut de colonne. Elle tenait ! Et puis elle devint la grincheuse
que je connais aujourd’hui, avec ses sautes d’humeur, ses exigences, ses
revendications. Et cela, en douceur, presque à mon insu. Les années vous
prennent ainsi, subrepticement. Souvent la priorité va aux
« sacrées », qui ne le sont pas puisqu’on y touche, et les
lombaires suivent, en bonne place. Et la marche se fait hésitante,
trébuchante, le regard apeuré. Rien que cette allure tâtonnante vous donne
vingt ans de plus. Ca s’appelle l’arthrose. Ca se
soigne un peu, et puis on fait avec. Mais ça ne fait pas mourir, ma
petite dame, au contraire, c’est un gage de longévité… Bien sûr ! Mais c’est surtout
l’interlocuteur que cela soulage, de ne pas être tenu de s’appesantir sur les
maux de l’âge. Pas encore… II J’aimerais bien, comme d’hab,
disent les jeunes, m’attaquer aux mots croisés de la Voix du Nord. Difficile ! Les caractères
sont petits, même quand j’ouvre grand les yeux. J’écoute les infos du matin, mais
les journalistes ont une diction épouvantable. De mon temps… Et cette musique
qui les submerge ! Alors je grogne. Même les aliments me trahissent…,
mais où sont les madeleines d’antan, mon pauvre Proust ? Jusqu’aux miroirs qui me renvoient
une vieille dame revêche et inconnue. Je les répudierai un jour prochain,
pour me mentir plus aisément. III Nous avons un club, comme il se
doit, c’est si stimulant de se retrouver entre vieux ! N’y aurait-il pas quelque part un
jeune, ou deux, à nous attribuer en retraite complémentaire ? Cette
ségrégation par l’âge est immorale. Elle n’existe pas dans les prisons ! Nous jouons à Pyramide, un jeu de
connaissances et de réflexes que la télé a cru bon évacuer de ses programmes
et auquel nous sacrifions avec plaisir chaque semaine. Il paraît que cela
stimule les neurones. Mais cela démoralise aussi quand le cerveau répond mal.
Mais l’ambiance est bonne. Je suis la doyenne. La doyenne des
vieux. C’est de l’acharnement ! Ce titre, que je n’ai jamais revendiqué,
m’est servi avec une parfaite courtoisie, et comme personne ne veut prendre
mon tour… Il faut faire face à l’élimination naturelle, le renouvellement du
monde est à ce prix. Ce faisant, j’ai tendance à
m’angoisser et à m’enrichir de tous les symptômes des maux en vigueur et cela
va de l’infarctus en puissance à la congestion cérébrale, avec un clin d’œil
en direction de Parkinson et son pote Alzheimer. Mais pour cette fois j’ai dû rendre
les armes devant une gastro ridicule que j’étais bien la seule à ne pas
connaître et dont le compte fut réglé en quarante huit heures. On ne peut se fier à
personne ! IV La maison est vide, d’autant plus
vide qu’elle fut pleine. Vous voyez ce que je veux dire ! Le silence
brutal et entier est angoissant. Et il devient, de plus en plus, le sinistre
privilège de l’âge. Forcément ! Les sorties sont
devenues de véritables expéditions. Il faut être accompagnée, avoir la forme,
pouvoir prendre son temps. Nous sommes devenus des freins à main, après avoir
été de piaffants moteurs. Dur dur d’être un passif ! Mais on peut encore geindre… et
regarder ce monde qui nous quitte ! J’aimerais seulement que
l’aide-soignante de la clinique ne m’appelât pas « mamie » et
cessât de ne voir en moi qu’une demeurée. Et que le jeunot qui me regarde
tenter ma chance sur ordinateur, dissimule avec plus de soin une supériorité,
pas si évidente que ça… Ceci dit, on s’y fait. Il reste un sujet à notre
portée : la maison de retraite ! On visite… Côté hygiène, soins, accueil, c’est
ok ! Il y a contrôle. Et compétence souvent. Mais nulle part je n’ai trouvé un
« lieu de vie ». Ce qu’on rencontre, c’est un lieu d’attente, de
convalescence peut-être, enfin un lieu provisoire, pour séjour souvent
définitif ! Les fenêtres donnent sur des talus
d’herbes mortes que personne ne foule, pas même un chien. Et le ciel,
par-dessus le toit ? Même pas ! Une frange bleu sale qu’on évite de
voir. A vous serrer le cœur ! J’espère que les architectes de ces
alvéoles vieilliront ! V Elle est debout la Mamie, toute
fringante ! Debout dans cette petite salle des
fêtes où la famille s’est assemblée en l’honneur d’une petite fille qui fait
ses débuts de comédienne. Mamie n’a pas de place. Nul n’en a
cure. On est transparent quand on a vieilli. Tout de même un petit-fils a
réalisé, et il parcourt les lieux d’un regard inquiet. Ah ! Voilà ! Dit-il avec
soulagement. Viens Mamie ! Là-bas… Sur le
côté… Je t’ai trouvé un strapontin ! Il est gêné le jeune garçon, la
place n’est guère confortable. Mais la grand-mère, gaillarde,
balaie les regrets d’un sourire, une place en vaut une autre ! Et,
désormais, il faut bien en convenir, et sans la moindre aigreur, le
strapontin, c’est la sienne ! Paule Lefebvre |
|
Le service est compris. |
|
|
|
« Dumerbion » :
caserne austère en plein cœur de Mézières, petite ville accueillante des
Ardennes. Le troisième régiment du Génie y a jeté l’ancre depuis une bonne
cinquantaine d’années, façon de s’exprimer dirons nous, on a là-bas plus les
pieds sur terre que dans l’eau, quoiqu’il arrive aux bidasses de naviguer sur la Meuse ou d’y construire des ponts factices et de les démonter
en un temps record, tâche bien souvent impartie aux petits bleus, ces jeunots
tout frais émoulus du giron de leur mère et à qui on donne un clé à mollette
pour remplacer le biberon. Certains grands bébés, les sursitaires a-t-on
coutume de les désigner, frisent les vingt-sept printemps et cohabitent avec
des nourrissons de dix-huit ans. Il est parfois délicat de rompre la glace au
vu de ces grandes différences d’âge
mais bien souvent un boute-en- train trouvera le moyen de détendre
l’atmosphère. Lemoine avait tenté l’impossible
pour se faire réformer : père en longue maladie, maman sans travail,
loyer de maison élevé mais il n’était pas sourd, pas assez myope, n’avait pas
de malformation cardiaque, pas de député pour le pistonner alors ses piètres
arguments n’eurent pas voix au
chapitre et il se retrouva sous les
drapeaux le premier Novembre 1967. L’armée n’était pas sa tasse de thé mais
ça valait sûrement mieux que le couvent. A l’époque, on ne badinait pas avec
les « classes » : deux mois sans permission où on menait
une vie quasi monacale, où on se farcissait d’insipides corvées dont je vous
épargnerai le détail, par décence. Le menu était épicé : il fallait en
baver pour mériter la fourragère mais le « troufion » possède de
solides capacités d’adaptation et aime se regarder dans une glace lorsqu’on
lui confie une délicate mission, si puérile soit-elle. De plus, pas un bleu
n’aurait osé contester l’autorité du « cabot chef » ou pis encore
du « juteux » ! Lupin serait entré dans une colère BLEUE
et l’affaire se serait soldée par « huit jours de trou » ;
inutile de l’apitoyer, il avait un cœur de glace et était intransigeant sur
le chapitre de la discipline. Dans le civil, Lemoine était
instituteur remplaçant. On pouvait alors enseigner sans passer par l’Ecole
Normale à condition d’obtenir son CAP d’enseignant à l’issue de deux années
de remplacements. Formation pratique, directement sur le terrain en présence
d’élèves, assortie d’un apprentissage théorique à raison d’une conférence
hebdomadaire et d’une dissertation à rendre tous les quinze jours. Très
rébarbatif d’ergoter par écrit sur la pédagogie, si peu motivant que Lemoine,
pourtant titulaire du bac Philo, rédigeait son pensum la veille de rendre le
devoir, à l’emporte-pièce, sans aucune recherche préalable, sans aucune
motivation. Ce qui devait arriver arriva : recalé à l’écrit du CAP, il
devait repiquer une année mais le spectre de l’incorporation se profilait. Il
décida de lever l’ancre et de casser le sursis : de toute façon, il en
avait marre et éprouvait le besoin de prendre du recul. Après tout, on
n’entre pas dans la grande maison Education Nationale comme dans un salon de
thé. Bien sûr, comme un bleu, «
l’instit. » emporte dans son barda la photocopie du diplôme du bac et
pas l’original. Fatale erreur. Au moment de l’accueil, il tombe sur un
« serre pattes », très zélé et froid comme la glace qui lui sort d’une
traite : « Ici, pas de toc, du vrai, pas de photocopie ;
de toute façon, elle n’est même pas certifiée conforme ; règlement,
règlement, jugulaire, jugulaire. Pour la peine, comme vous avez une bonne
tête, je vous mets sur votre livret militaire, par protection, Certificat
d’Etudes Primaires, et je suis bien bon, croyez-moi ». Déchu de son
niveau d’études et un instant décontenancé, le maître d’école enrôlé de force
ne se hasarde pourtant pas à protester : « Le Chef a toujours
raison, même s’il a tort ». Si le besoin s’en fait sentir, il apportera
l’original au retour d’une permission et tout le monde sera content. Au pire,
en dernier ressort, contre quelques paquets de clopes et sur production de la
pièce authentique, il trouvera bien moyen de faire corriger le tir en magouillant
et les supérieurs n’y verront que du bleu. Contre toute attente, les classes
se passent sans encombre et, au retour de la première permission, Jules
Lemoine emmène dans sa valise le précieux document dont il se jure de tirer
profit à la première occasion. Désigné de corvée pour entretenir la chambre
d’un sous lieutenant, il lui raconte sa rocambolesque histoire et ce dernier,
sans sourciller, rectifie la bévue de sa propre main. L’honneur du corps
enseignant est sauf ! A force de persuasion et démonstration
de bonne conduite, le disciple de Ferry se vit confier la délicate mission de
préparer au certificat d’études les demeurés du contingent. Pas question de
se planter sur ce coup-là : l’armée ne transige pas avec les incapables.
Ses angoisses n’étaient pas fondées, et pour cause : il obtint des résultats plus qu’honorables pour la
classe mobilisée. Sa réputation d’éminent pédagogue arriva aux oreilles du
lieutenant colonel, l’officier
conseil. Tout se sait à la caserne. Ce dernier lui fit surveiller des
épreuves d’admission à Saint Cyr, mission de la plus haute importance. Bien
qu’étant toujours« deuxième pompe », la bleusaille avait pris
du galon. Avril 1968. Des rumeurs
circulaient. La révolution grondait sur Paris. Le troisième Génie n’était pas
loin de revêtir ses bleus de travail
pour participer à la neutralisation de la capitale. Mai68. On diffusa
la nouvelle à la vitesse de la poudre : toute la caserne était partante,
à l’exception de quelques planqués, du personnel d’intendance et de quelques
veinards partis dans leurs foyers et dont les trains de retour étaient passés
au bleu. L’officier conseil ne voulut pas se priver des services du
« premier sapeur »Lemoine, monté en grade pour services
exceptionnels d’instruction rendus à la patrie en péril. Son propre
commandant le déclarait « Bon pour Versailles » mais il dut
s’incliner devant l’autorité supérieure à l’issue d’une joute verbale aux
propos épicés, spécialité de la gent militaire : quand un commandant
croise le fer avec un lieutenant colonel, les lames bleues des bretteurs font
rougir de honte leurs épouses qui prennent le thé ! Mine de rien, Jules se la jouait
très fine et préparait ses arrières à Dumerbion. Certes, sa brillante
promotion du « certif » ne manquerait pas d’aller servir un thé
glacé aux manifestants du Grand Trianon, ce qui le mettait d’office au
chômage et le rendait mobilisable par ce regrettable coup du destin, mais il
s’était laissé dire que le barman du mess, en permission ne pouvait rentrer
chez lui faute de locos et wagons ensevelis sous les barricades. Le dénommé Vichy, serveur patenté mais qui
ne buvait jamais d’eau, sauf durant le service, avait donc provisoirement
pris sa place derrière le comptoir et une place en salle attendait celui qui
saurait saisir l’opportunité. Heureusement la concurrence était maigre, les
sapeurs s’affairant à préparer le barda et lever l’ancre, en camions bondés,
cap Sud Ouest, sur l’île de France. L’officier conseil, d’une éternelle
reconnaissance, lui offrit sur un plateau, son tablier de serveur : - Sapeur Lemoine, vous êtes
dispensé de grande manœuvre pour le moment. Votre devoir de soldat vous
appelle au mess à servir en table. A en juger par votre prestance, vous
n’aurez aucun mal à livrer sans encombre les biftecks bien bleus aux « sous
off ». Quand l’insurrection sera matée, il sera temps pour vous de
rouvrir avec les potaches le livre au chapitre où vous l’aviez laissé.
Attention, ce n’est pas une sinécure : cent cinquante couverts à vous
répartir à trois, trois services dans la journée, matin, midi et soir. Ce
n’est pas un boulot de petit bleu : toujours le sourire, tenue
irréprochable, pas le droit à l’erreur : « viré » si la
tasse de thé passe par dessus bord ou si l’assiette atterrit sur la vareuse.
A Dumerbion, on ne décore pas les galons avec les macaronis, c’est bien
compris ? ! Des questions ? - Est-ce que nous sommes soumis au
même régime que les autres ? - Non, non, vous faites bien de me
le signaler, j’oubliais : exempt de tir, de corvée, de défilé, de manœuvre, de revue de casernement.
Permission à tour de rôle, une semaine sur trois, en rotation. Quartier libre
tous les après midis, après la corvée de vaisselle, soit de quinze heures à
dix -huit heures. En un mot, vous servez le pays en servant à table. Rien
d’autre ? - Ce sera tout mon lieutenant
colonel ; à vos ordres ! - Rompez, sapeur Lemoine ! Je
suis plus qu’en retard ; mon épouse donne un thé. Si elle ne me voit pas
débouler avant cinq minutes, je vais me faire remonter les bretelles. Vous
savez ce que c’est avec les femmes d’officier, les maris n’ont pas voix
au chapitre : ces diablesses portent la culotte ! Emoustillé par ses nouvelles
fonctions, Jules s’en donnait à cœur joie et se dépensait sans compter,
virevoltant d’une table à une autre avec grâce et élégance, répondant
finement aux propos épicés, devenant jour après jour un pilier du mess
apprécié à sa juste valeur pour sa compétence notoire et sa grande
affabilité. « Quel faillot ! », diraient certains dans le
jargon militaire. Pendant ce temps-là, les « Gavroches » du
vingtième siècle balançaient leurs derniers pavés sur les boucliers des CRS.
La rupture de stock devenait inéluctable et sonnait le glas des
revendications. Sur fond de paix sociale retrouvée, le régiment au grand
complet, pas une victime, pas un blessé, ni même une égratignure, la gloire
en quelque sorte, fit sa grande rentrée à Dumerbion mieux que Jules César,
pas Lemoine, celui-là avait su se planquer, au retour de campagne. Les
derniers incorporés avaient même construit un arc de triomphe
métallique : autant que l’entraînement serve à quelque chose. Parades,
défilés, discours grandiloquents rendirent hommage aux sauveurs de la
nation ; les bleus du dernier
cru avaient les larmes aux yeux, les vieux baroudeurs à la vareuse criblée de
décorations restaient de glace : « Ils en avaient vu
d’autres ». La démonstration de force inquiétait le sieur Lemoine sur le chemin de la
destitution. Encore une fois, il fut sauvé par un fabuleux concours de
circonstances : Bouvier, le barman, avait pu enfin prendre le train, les
voies étaient déblayées ; sitôt rentré à Mézières, il rendit ses effets
militaires et regagna définitivement ses foyers. Le paquetage à la sortie
était bien lourd : quelques treillis passèrent au bleu, moyennant trois
paquets de « troupes » pour acheter la discrétion du douanier,
fumeur invétéré. Ces « bleus de travail », de couleur kaki,
sont d’une solidité à toute épreuve et d’autant plus appréciés quand on peut
les chaparder. Faut bien conserver un souvenir du service militaire pour que son utilité soit comprise par
la famille du bidasse ! Au
final, tour de passe-passe : Vichy devient barman en titre, gare à
l’alcootest, Lemoine est promu au grade de serveur titulaire, les ouailles
analphabètes attendent un remplaçant, ça doit pouvoir se trouver dans le
campus. Les conditions de travail devinrent
moins exténuantes : en effet, lors des événements de Mai 68, des
régiments faisaient escale à Dumerbion et il était courant de servir cent
cinquante, deux cents couverts trois fois par jour ; ça n’avait rien à
voir avec un salon de thé peinard ! Le calme revenu sur la Gaule, les
guerriers de passage réintégrèrent leurs tribus au grand soulagement des
serveurs dont la liquette, en fin de service, avait une odeur particulièrement
épicée. On divisa par trois ou quatre le nombre de couverts servis à chaque
repas. Il fallut « meubler » pendant les trois heures de
récupération de l’après midi. C’est alors que Lemoine, gagné par la sagesse,
décida de passer par correspondance son CAP d’instituteur au lieu de taper la
belote ou picoler avec les copains. Bien lui en prit : il obtint des
notes brillantes aux dissertations proposées et, libéré par anticipation deux
jours plus tôt pour cause d’examen pédagogique, fut reçu premier des
« bleus de la promotion des instituteurs remplaçants ».
Démonstration fut faite par le sapeur Lemoine que « Lorsqu’on ne
suce pas la glace à l’armée et qu’on préfère la pédagogie aux mets plus
épicés, on a voix au chapitre de retour à la vie civile et on peut lever
l’ancre pour des rivages enchanteurs ». Méfions nous de l’expression :
« L’armée n’est pas ma tasse de thé ». Grasjacqs. |
|
HISTOIRE DE CLASSE |
||
|
|
|
|
LES ECHEVAUX DU DESTIN (Extrait) |
|
|
|
Joseph se présenta finalement au
centre de mobilisation de Lyon, le 1er mars 1916, alors qu’un nom
nouveau avait fait son apparition dans l’histoire de France : Verdun. A quelques mois de son
incorporation, son engagement fut accepté après une rapide visite médicale.
Pour la première fois de sa vie, Joseph fut confronté à la promiscuité de la
vie collective, se retrouvant au milieu de beaucoup de jeunes gens de son
âge, qui, partageant le même enthousiasme, voulaient servir la mère patrie,
sans état d’âme. Dans une caserne grise et froide,
après avoir remarqué que le pantalon rouge tant décrié par son grand-père
avait disparu du paquetage, Joseph fit le dur apprentissage de la vie
militaire. Les exercices s’enchaînaient sans laisser aux nouvelles recrues le
temps de se reposer. Il fallut apprendre à manier le fameux fusil Lebel, les
grenades, mais aussi des armes collectives, et en particulier la mitrailleuse
Hotchkiss. Joseph se fit remarquer pour son entrain et son courage. Sachant
réconforter ses camarades prêts à craquer, il joua un grand rôle dans la
cohésion de sa section d’instruction. Mais ce temps de formation passa bien
vite et, après quelques semaines, les nouveaux soldats furent dispersés dans
des unités différentes. Ils se séparèrent le cœur serré, certains que nombre
d’entre eux alimenteraient la liste déjà très longue des victimes du conflit.
Joseph Fervel fut affecté au 65e régiment d’infanterie, qui devait
être dirigé vers le front de Verdun, où fondaient, comme dans un chaudron
diabolique, les forces vives de l’armée. Là se jouaient la guerre et le
destin du pays. Malgré des privations, une misère psychologique et matérielle
toujours plus forte, Joseph ne se plaignait jamais. Il avait choisi sa
condition de soldat. Le véritable baptême du feu pour
Joseph Fervel eut pour cadre, le 6 mai 1916, la côte 304, haut lieu de
l’héroïsme de l’armée française. Son régiment avait été conduit par camions
jusqu’à quelques kilomètres des combats. L’approche du secteur de première
ligne fut ensuite très pénible et lamina d’entrée les forces des combattants.
Plusieurs fois, Joseph ferma les yeux quelques secondes afin de reprendre ses
esprits, et se mordit la langue pour ne pas pleurer. Bouleversé par l’artillerie, le
terrain ne permettait plus le creusement de galeries. Comme ses camarades, Joseph
progressait le dos courbé, écrasé par son barda, son fusil, ses munitions et
ses vivres de réserve. Cette approche sur plus de deux kilomètres se fit sous
le tir incessant des canons et des mitrailleuses. La compagnie de Joseph mit
ainsi plus de dix heures pour enfin prendre position, en pleine nuit. Joseph découvrit dans cette
première grande épreuve la signification du mot fraternité. Certains soldats
tombaient dans des trous d’eau béants où ils auraient pu se noyer.
Rapidement, plusieurs camarades se précipitaient pour les aider à sortir du
piège. On échangeait alors une gorgée d’eau, un bout de pain. Ces premières
heures, Joseph les trouva interminables, d’autant qu’il tomba lui-même dans
un de ces trous et qu’il en sortit trempé jusqu’aux os. Sans vêtements de
rechange, il n’eut ni l’occasion de se plaindre, ni le temps d’y penser. Il
passa la nuit à trembler. Dès le petit jour, l’artillerie
allemande se déchaîna. Joseph apprit à cette occasion ce que recoupait le
terme « feu roulant ». Dans la tranchée, les hommes se serrèrent un
peu plus, ne pouvant rien opposer d’autre que leurs poitrines aux orages
d’acier qui éclataient au-dessus de leurs têtes. Alfred Lenglet . |
|
|
VACANCES DE REVE Henri lève les yeux par-dessus ses
lunettes. Quel silence ! Un silence inquiétant. Il se précipite ;
ce qu’il voit ne l’étonne pas : Claire est agrippée à la table de la
cuisine, suffoquant. Il cherche dans la poche de son
tablier le médicament sauveur : l’inhalateur qui ne la quitte jamais.
Elle le trouve, inhale une ou deux bouffées, retombe sur le tabouret,
épuisée. Henri retient le sermon habituel
qui exaspère Claire et aggrave son état. « Tu ne dois pas te fatiguer…
il faut être raisonnable ». Or Claire n’est pas
raisonnable ; depuis trois jours, Henri, mi amusé, mi agacé, a dû subir
en son entier le répertoire de Charles Trenet, chanté par une Claire au mieux
de sa forme, passant l’aspirateur, chassant le moindre grain de poussière,
vaporisant l’insecticide (ô l’imprudente !), préparant les conserves de
petits pois et de haricots verts frais cueillis. Elle est heureuse, exaltée,
épuisée. Henri tente timidement de calmer
son ardeur : « La maison est impeccable.
Inutile de te donner tout ce mal ! Crois-tu que les enfants vont
inspecter les armoires, passer le doigt sur les meubles pour vérifier
l’absence de poussière ? » « Oh toi ! »,
marmonne Claire, tout en continuant à astiquer, frotter, brosser. Henri hausse les épaules, affectant
de sourire pour cacher son inquiétude. Il pressent, redoute la
catastrophe : la crise grave qui nécessite l’hospitalisation. Il propose
son aide. « Bon ! Alors, monte donc
tout ça au grenier… Moi, je n’en ai plus la force. » Henri considère « tout
ça » avec une certaine inquiétude. Le pourra t-il, lui ? A plus de
soixante dix ans, avec ses rhumatismes, son arthrose ! Comment avouer
ses faiblesses à Claire ? Les rares fois où il a fait allusion à son
âge, à ses problèmes de santé, Claire a blêmi. Son inquiétude faisait peine à voir. Henri s’en est tiré par sa
plaisanterie habituelle : « Ne t’en fais pas, j’en ai
encore pour une petite cinquantaine d’années ! » Pour l’heure, il se contente de
dire : « Bon ! Il faudra
plusieurs voyages. » « Ensuite, tu m’aideras à
recouvrir les pots de confiture », poursuit Claire, impitoyable. Là, c’en est trop, Henri se
fâche : « Quelle idée saugrenue de te
lancer dans la confection de confitures, en ce moment ! » Il se fait rembarrer de la belle
manière : « Tu sais bien que « les
petits adorent mes confitures ». Les petits, actuellement âgés de
quatorze et douze ans, s’intéressent davantage aux jeux vidéos et aux
skate-boards qu’aux confitures de Mémé. Henri a surpris une conversation
révélatrice qu’il s’est bien gardé de rapporter à Claire : « Tu les aimes,
toi ? » disait Sébastien en désignant du doigt les pots sagement
alignés sur la table. « Bof !... Je préfère
celles que Maman achète au supermarché», avait répliqué Sophie, impitoyable… « Mais chut… faut pas le dire
à Mémé, ça lui ferait de la peine ! » Ils sont gentils, ces
enfants ! Henri se réjouit de les
revoir ! De quand date leur dernière visite ?... Dix huit
mois !... Oui, c’est ça, dix huit mois !... L’avant dernier Noël.
Chaque fois que les enfants annonçaient leur visite, un événement
contrecarrait leur projet : les oreillons de Sophie, l’appendicite de
Sébastien, et l’an dernier l’invitation des Dumont qui venaient d’acquérir
une propriété à Bormes-les-Mimosas. Comment résister ? La Côte
d’Azur, le soleil, la mer toute proche, les copains de leur âge, les sports
nautiques. « Aussi variés que
dangereux » avait rétorqué Claire en brandissant le journal. « Tiens… Lis toi-même… Deux
jeunes nageurs imprudents se noient… Un surfeur est recueilli de justesse par
un yachtman ! » « Les enfants seraient bien
mieux ici… dans la piscine ! » Henri avait retenu de justesse un
sourire ironique en contemplant la dite piscine tout juste bonne aux bains de
pieds rafraîchissants qui faisaient tant de bien à Claire. « Enfin, cette année nous les
aurons ! » soupire Claire qui a suivi et deviné les pensées
d’Henri. « Tu te souviens de la joie
des enfants quand nous avons acheté la maison ? » « Oh ! Papa… ce sera
formidable pour les vacances ! » avait clamé Xavier, jeune
enseignant, fiancé à une collègue. « Oh ! Oui, ce sera
formidable ! » avait renchéri Hélène la cadette. « Au moins, nous saurons où
passer nos vacances… et quand nous aurons des enfants !!! » Claire et Henri imaginaient déjà
des bébés aussi nombreux que beaux, barbotant dans la piscine, car il y
aurait une piscine et des balançoires, et des agrès, un endroit spécialement
aménagé pour les bains de soleil !... Le rêve ! Un rêve ?
Non ! Une réalité : une vieille maison à restaurer, découverte dans
le sud de la France par le plus grand des hasards. Une affaire à saisir
« de suite », c’est ce qu’annonçait la pancarte. « Il y aura des
travaux ! » « Ce n’est rien !... On
t’aidera, Papa ! » Ils étaient devenus les heureux
propriétaires d’une maison où pratiquement tout était à refaire. Mais, Dieu,
qu’ils étaient heureux ! Heureux et fatigués. Les vacances scolaires étaient bien
employées : maçonner, peindre, tapisser, installer une salle de bains,
des W.C, entretenir l’immense jardin. Avec l’aide de Xavier, de sa fiancée
Sabine et d’Hélène… les travaux avançaient vite. Hélas, l’année suivante, Xavier et Sabine mariés étaient partis
en voyage de noces à la Réunion. Hélène effectuait un périple linguistique
aux U.S.A. Claire et Henri s’étaient vus contraints de faire appel à des
professionnels. Les maçons, les plâtriers, les menuisiers, les carreleurs,
unanimes, avaient décrété que le travail avait été, selon leur expression,
« salopé ». Ils avaient donc démoli presque tout ce que Claire,
Henri et les enfants avaient édifié à grand-peine. Claire s’affolait de vivre dans un
chantier tandis que s’accumulaient les factures et que le compte en banque
fondait à vue d’œil… Henri s’efforçait de se rendre utile mais, selon les
hommes de l’art, faisait pire que mieux. Découragé, il avait abandonné et
s’était remis aux mots croisés. Enfin, au bout d’un an, la maison
était habitable, sinon confortable. Henri et Claire, maintenant
retraités de l’Enseignement, s’étaient installés définitivement en Corrèze. Xavier et Sabine avaient annoncé
leur visite pour le mois de Juillet. Folle de joie, Claire, envisageant un
long séjour, avait accumulé les provisions, aménagé les chambres, brossé,
frotté, ciré. Tout devait être impeccable. Beaucoup de fatigue pour peu de
chose : un court séjour de moins d’une semaine ; une semaine qui
avait filé comme l’éclair. « Déjà ! » avait murmuré Claire en
les accompagnant vers la voiture toute neuve qui devait les emporter vers
l’Italie. « Nous aurions dû nous
installer sur la Côte d’Azur ! » Henri s’était bien gardé de faire
remarquer que cela n’aurait pas changé grand-chose à la situation. Comment
rivaliser avec les amis de leur âge ? Eux, ils n’étaient que les
parents : la Révolution de 68 était passée par là. En ce qui concerne Hélène, c’était
pis. Elle s’était installée aux U.S.A et avait fait la connaissance de
Donald, qu’elle comptait épouser. En dix huit mois, une brève apparition pour
annoncer qu’elle se mariait le mois suivant dans la plus stricte intimité. Il
n’y aurait ni cérémonie, ni réception. « De toutes façons, si on
réfléchit bien, ça ne concerne que Donald et moi. » « Prends ça dans les
gencives », avait pensé Henri. Claire, profondément déçue, n’avait
pu s’empêcher d’exprimer sa pensée : « Moi, j’appelle ça se marier
comme des voleurs ! » Désormais, Claire et Henri
s’installaient sur le vieux banc de pierre adossé au mur de la maison et
contemplaient les champs de lavande. « Bah, tout changera quand ils
auront des enfants ! » « Tu crois ? »
disait Claire, en levant vers Henri un regard triste où brillait néanmoins
une lueur d’espoir. « C’est évident ! » « Quand même, nous avons eu
tort de venir nous enterrer ici. Non seulement nous ne voyons plus les
enfants, mais nous sommes loin de tous nos amis. » « Tu n’es jamais
contente », bougonnait Henri. Mais il partageait l’opinion de sa
femme. C’était loin, beaucoup trop loin de leurs racines, et trop grand,
beaucoup trop grand pour deux retraités vieillissants. Bientôt il faudrait
faire appel à une entreprise pour entretenir l’immense jardin et le verger
qui produisait des fruits qu’on ne cueillait jamais, Claire s’opposant au
projet d’Henri de grimper à l’échelle pour une récolte de qualité médiocre.
Ne devient pas pépiniériste qui veut ! Henri avait cédé d’autant plus
facilement qu’un voisin plus tout jeune était tombé en voulant cueillir des
fruits et s’était empalé sur une bêche retournée. Depuis il traînait
d’hôpital en hôpital. « Tu vois ! avait
dit Claire. Nous n’avons plus l’âge de faire le guignol sur une
échelle. » Le guignol avait rétorqué : « Toi non plus tu n’as plus
l’âge d’entretenir seule cette immense maison. Il faudrait engager une femme
de ménage. » « Jamais de la vie !...
Je servirais à quoi, moi !... et puis je n’aime pas qu’on déplace les
objets… et puis je n’aime pas qu’on tripote mes affaires personnelles… et
puis je ne tiens pas à avoir quelqu’un dans mes jambes… et puis, et puis, et
puis… La liste des récriminations était interminable. « Quelques heures par semaine ?... » « Non, non et
NON ! » La discussion menaçant de
s’envenimer, Henri s’était efforcé de la détourner : « Enfin !... cette année,
les enfants viennent nous rendre visite. » « J’espère qu’ils resteront au
moins trois semaines !... au moins… » Et voilà Claire repartie au Pays
des Illusions dont elle revient à chaque fois plus déçue… Henri s’affole,
sans le montrer : elle est devenue si fragile !... il prêche la
prudence : « Trois semaines ?...
C’est peut-être beaucoup demander… Sabine voudra certainement rendre visite à
ses parents… en Alsace. » « Non !... cette année,
c’est notre tour !... affirme Claire… D’ailleurs j’ai déjà tout
préparé ! » Que dire ? Henri soupire.
L’amour maternel ôte à Claire toute lucidité. C’est pourtant une femme
intelligente, mais quand il s’agit de SES enfants, elle perd toute faculté de
raisonnement logique. Et voilà ! Tout est prêt. Tout
le monde est au garde-à-vous, même les pots de confiture dûment étiquetés et
datés qui s’alignent comme des soldats le 14 Juillet. « Bon, je leur réserve douze
pots !... Va me chercher un carton au grenier… Bien solide, le
carton !... Je dois y mettre aussi les confits de canard. » Henri fait justement remarquer que la voiture de Xavier n’est
pas un camion… et qu’ils ont probablement beaucoup de bagages. « J’attends le
carton !!... Tu te dépêches ?... » Résigné, Henri s’exécute et le
carton est rempli ! Il ne reste plus qu’à attendre le coup de téléphone
promis. « Xavier a dit :
« J’appellerai vers 17 h » et il est déjà 17 h 30. » « Bah !... Un imprévu…
des embouteillages… C’est normal en période de vacances ! Ca nous est
arrivé souvent… Rappelle-toi !... » Claire se rappelle mais cela ne
l’empêche pas de s’inquiéter… Elle regarde la pendule, puis Henri qui feint
le calme, ce qui énerve Claire. Enfin le téléphone ! Il se précipite.
Trop tard ! Comme toujours, Claire a saisi l’écouteur la première. Elle
sourit. « Ah ! C’est toi
Xavier ?... Nous commencions à nous inquiéter, ton père et moi… A quelle
heure serez-vous ici ?... Ah !... Ah !... Oh bon !...
Non, non !... Ne vous en faites pas pour nous !... Nous
t’embrassons !... Surtout, soyez prudents !... Dis aux enfants de
ne pas nager trop loin de la côte !... Oui ! Ah !... Peut-être
au retour ?... C’est parfait. Papa vous embrasse. » Claire raccroche lentement ce
maudit téléphone. Elle ne dit rien, c’est inutile, Henri a compris : « Ils ne viennent pas !
C’est une affirmation. » « Peut-être au
retour ! » « Oui… Oh ça !... Je n’y
crois pas ! » Claire acquiesce !... Elle
pleure ! Henri, lui, ne pleure pas, mais il est triste, inquiet pour
Claire, il la connaît, elle va se rendre malade. Les enfants n’en sauront
jamais rien ! Elle le lui a fait jurer : elle refuse le chantage
aux sentiments. Elle trouve cela mesquin. Henri a promis. Il tiendra sa promesse.
D’ailleurs, à quoi servirait d’exiger une visite et d’accueillir des enfants
maussades, pressés de retrouver leurs amis ? Ce serait pis que tout.
Henri s’approche de Claire, l’enlace, retrouve les gestes d’autrefois quand
ils se sont connus… il y a longtemps, si longtemps. Elle le regarde. Il lui
dit : « Je suis là,
moi ! » Elle acquiesce, retrouve un sourire
pour répondre : « C’est vrai !... Tu es
là… Tu es toujours là quand j’ai besoin de toi ! » Elle ajoute tout bas : « C’est l’essentiel !
Nous avons beaucoup de chance. » Geneviève Demarcq 62 Wimereux |
|
UN PETIT RIEN |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
HECTOR MELON D'AUBIER … après '' LE RESSUSCITE '' présente MIN GRIND PERE Y DISOT TOUDIS En nouvelle version rééditée Recueil anecdotique d'histoires
patoisantes, de faits divers, de situations cocasses que toutes et tous, nous
avons connu ou dont nous avons entendu parler. Aux Editions OLIVIERY France 96 PAGES 10,O2 Euros Pour
commander : 25 avenue LAMBERT
LIGNY en Cis 59191 ( 03 27 85 55 82 ed.oliviery@orange.fr |